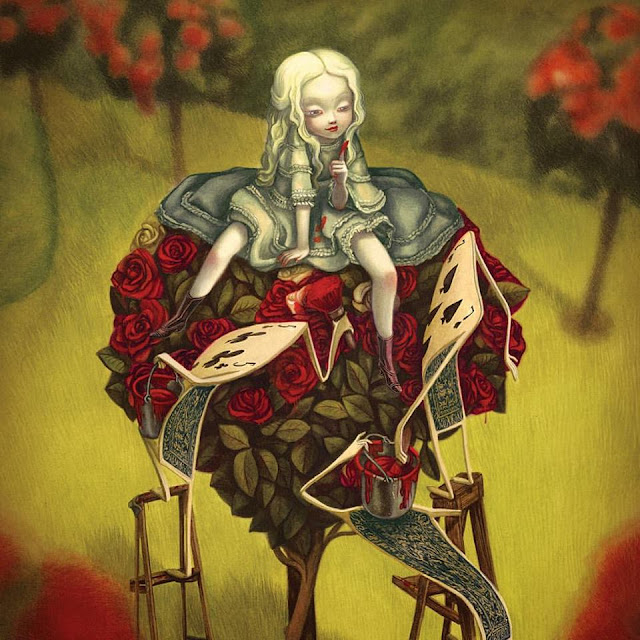Oui bon, je crois que pour une critique objective, vous n'êtes pas au bon endroit. Willy Wonka, propriétaire d'une chocolaterie loufoque où personne n'a pénétré depuis quinze ans, va organiser une loterie qui permettra à quelques enfants de visiter sa mystérieuse confiserie. Le principe est simple : parmi des milliards de tablettes de chocolat vendues dans le monde, seulement cinq d'entre elles contiennent un ticket d'or. Les enfants qui découvriront un de ces tickets seront donc invités par Wonka. Parmi eux, Charlie est un petit garçon issu d'une famille pauvre, dont le grand-père est un ancien ouvrier de la chocolaterie. Disons les choses clairement, ce personnage est un prétexte, une sorte de faire-valoir qui nous invite à apprécier la chocolaterie d'un œil enfantin, pour mieux nous faire lorgner du côté du vrai héros (ou plutôt anti-héros) de l'histoire. Sous ses airs enfantins, ce film tend vers une satire grinçante et décalée de l'éducation, de l'incidence de l'enfance sur la construction des individus, du développement de l'industrie au profit de l'emploi (déjà).
Cette usine futuriste est donc truffée de trouvailles multicolores, d'excès et de délires en tout genre, de joie et d'excentricité, en opposition avec l'ensemble de la ville terne qui l'entoure. D'ailleurs, la maison de Charlie n'est pas sans rappeler le manoir d'Edward aux mains d'argent, un peu branlant, carrément mal foutu, ne tenant même pas sur ses fondations, une vraie bâtisse burtonnienne. Le réalisateur a bien sûr gribouillé lui-même les croquis de ses décors et a tenu à les construire en dur, tout comme les marionnettes à l'effigie de Deep Roy, dupliquant des Oompa Loompa surexcités à l'infini. Lors de cette visite endiablée, Willy Wonka profitera de l'occasion pour régler son compte à une société qui ne lui a jamais vraiment fait de cadeau : il va piéger les gamins pourris gâtés, prétentieux et arrogants en jouant sur leur corde sensible, et donner une bonne leçon aux parents qui ont osé engendrer des petits monstres pareils (si seulement je pouvais faire ça dans mon boulot, mais là je m'égare). Sans surprise, l'héritage reviendra à Charlie, gamin pauvre et sensible, respectueux de sa famille, généreux et curieux de tout. Tout va bien, la morale et sauve. Et puis on y retrouve l'un de ses thèmes préférés, à savoir sa volonté à nous montrer les gens normaux sont en fait plus tarés et dangereux que les doux dingues comme Willy Wonka.
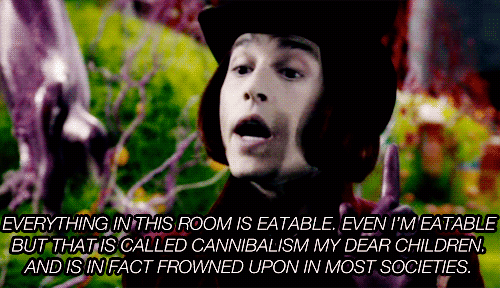
Dans un premier temps, on peut le voir comme une sorte de prédateur, avec les éliminations successives des enfants et son côté malsain clairement assumé. Celui qui est censé lui succéder doit répondre à de nombreux critères, connus de lui seul. Les cinq enfants qui ont eu la chance de découvrir les fameux tickets d'or risquent finalement d'être des proies bien vite bazardées si elles ne font pas l'affaire. Mais Willy Wonka est aussi un artiste, et Tim Burton est fasciné par les artistes, il en est lui-même un, et c'est une chose qu'il adore mettre en scène. Tout comme Wonka, son style hors-normes ne fait pas l'unanimité, certains (comme moi) l'adulent, d'autres le détestent, sans qu'il existe vraiment de juste milieu. L'art a des conséquences, bonnes ou mauvaises (égocentrisme, incitation à la consommation, exploitation, industrialisation de masse, mais aussi réflexions sur le monde, construction de soi et créativité sans borne) et c'est également ce qu'évoque Charlie et la Chocolaterie. On retrouve la patte du réalisateur, autant visuellement qu'au niveau de l'humour, noir à souhait (comme le chocolat, il fallait bien que je vous la fasse, celle-là). Willy Wonka, incarné par un Johnny Depp méconnaissable, est d'ailleurs le genre de personnages auxquels je m'attache très rapidement, tout en nuances et en contradictions. Le petit Charlie contrebalance un peu toute cette froideur joviale, il s'agit d'un enfant doux et calme, l'exact opposé du chocolatier. Les deux vont pourtant se trouver de nombreuses similitudes, car c'est aussi un des sujets du film, celui des apparences. Derrière ses lunettes et sa tenue excentrique, Wonka est un homme mal à l'aise en société, un créateur génial mais très timide, presque associable. Je ne peux m'empêcher de voir un parallèle évident avec Tim Burton lui-même. Tout ceci est appuyé par la composition de Danny Elfman, qui semble très inspiré. Le générique totalement barré me séduit complètement à chaque fois (cette musique occupe d'ailleurs une très bonne place dans mon MP3) :
Cette usine futuriste est donc truffée de trouvailles multicolores, d'excès et de délires en tout genre, de joie et d'excentricité, en opposition avec l'ensemble de la ville terne qui l'entoure. D'ailleurs, la maison de Charlie n'est pas sans rappeler le manoir d'Edward aux mains d'argent, un peu branlant, carrément mal foutu, ne tenant même pas sur ses fondations, une vraie bâtisse burtonnienne. Le réalisateur a bien sûr gribouillé lui-même les croquis de ses décors et a tenu à les construire en dur, tout comme les marionnettes à l'effigie de Deep Roy, dupliquant des Oompa Loompa surexcités à l'infini. Lors de cette visite endiablée, Willy Wonka profitera de l'occasion pour régler son compte à une société qui ne lui a jamais vraiment fait de cadeau : il va piéger les gamins pourris gâtés, prétentieux et arrogants en jouant sur leur corde sensible, et donner une bonne leçon aux parents qui ont osé engendrer des petits monstres pareils (si seulement je pouvais faire ça dans mon boulot, mais là je m'égare). Sans surprise, l'héritage reviendra à Charlie, gamin pauvre et sensible, respectueux de sa famille, généreux et curieux de tout. Tout va bien, la morale et sauve. Et puis on y retrouve l'un de ses thèmes préférés, à savoir sa volonté à nous montrer les gens normaux sont en fait plus tarés et dangereux que les doux dingues comme Willy Wonka.
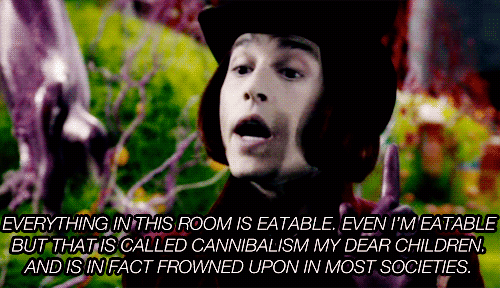
Ces nombreux niveaux de lecture n'empêchent pas Charlie et la Chocolaterie de rester un divertissement familial adapté à tous (et surtout aux parents, si vous voyez ce que je veux dire). Prévoir avec vous quelques trucs à grignoter, parce qu'à voir tout ce chocolat, on a plus d'une fois l'envie de se lever pour aller chercher à bouffer.


Pour aller plus loin : La conception et la naissance des Oompa Loompa