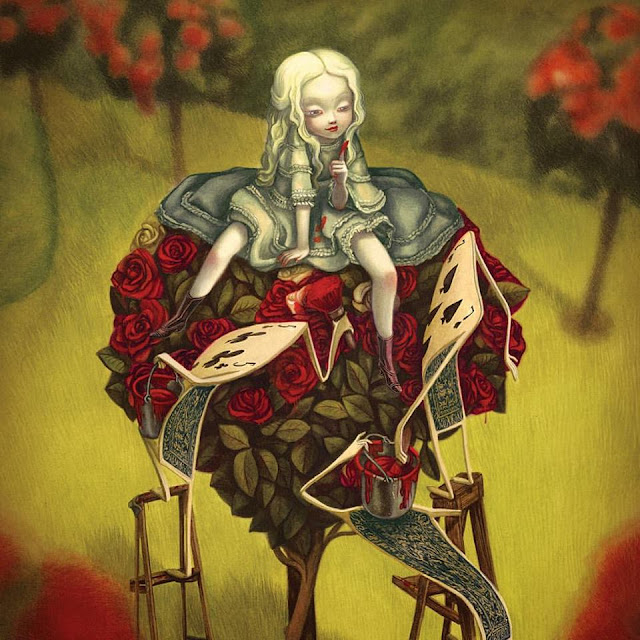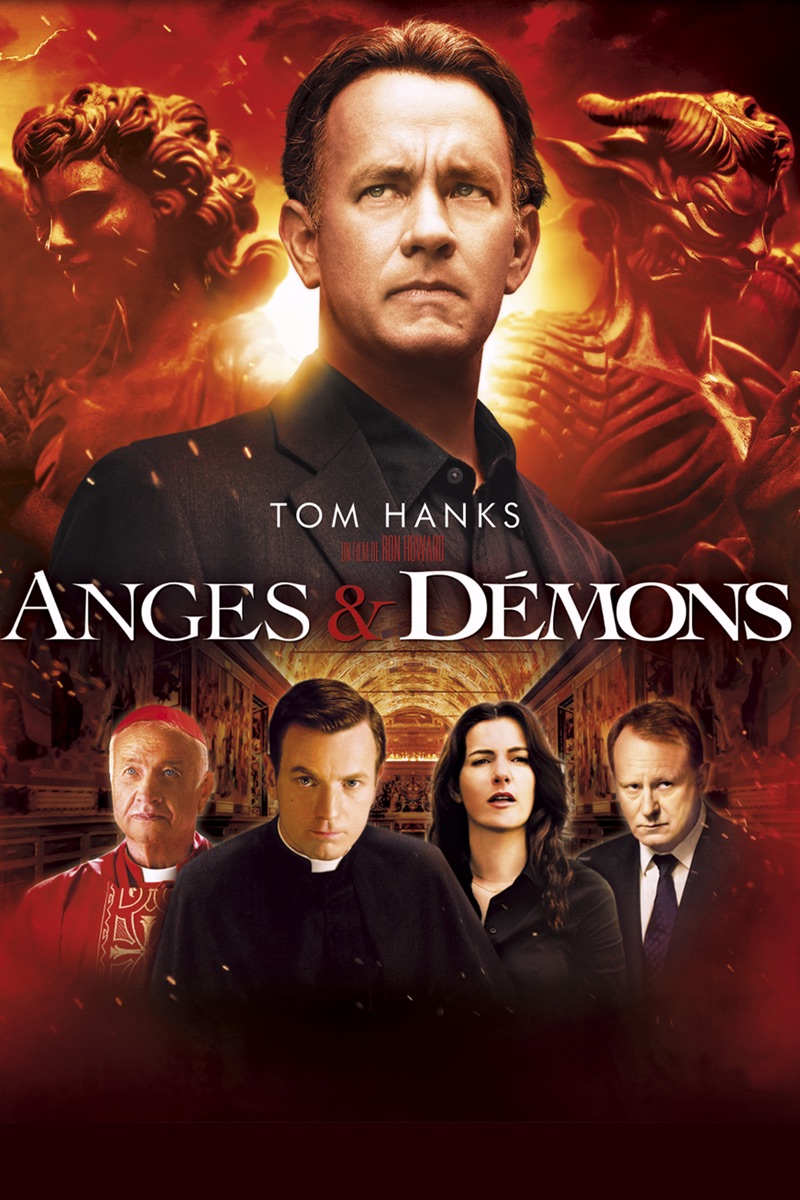Qu'on s'entende bien. Oui, généralement quand un article commence par ce genre de phrases, ce n'est pas bon pour la suite, mais qu'on s'entende bien : j'adore Jean-Christophe Grangé. Quand j'étais au lycée, j'entamais Miserere et dévorais dans la foulée son oeuvre la plus connue, Les Rivières Pourpres. Cet auteur a un don indéniable pour inventer des tueurs qui font des trucs dégueu, à grands renforts d'une écriture simple et rythmée qui nous embarque rapidement dans l'engrenage. J'étais donc dans de très bonnes dispositions à l'égard de Lontano, son dernier roman, même si je n'avais pas aimé le précédent.
Habituellement, les résumés de ses livres ne donnent aucun indice sur l'histoire, mais cette fois-ci, l'éditeur nous la fait à l'ancienne, quitte à en raconter un peu trop :
"Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. La petite soeur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l’Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d’intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont surtout faire face à bien pire : leurs propres démons. Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan enfouissent leurs morts sous les ors de la République."
Sur le papier, ça n'a pas l'air mauvais, donc.
Et pourtant, ce livre est un excellent exemple de ratage, sur plusieurs niveaux. Le patriarche joue son rôle de patriarche, le flic fait son travail de flic, son frère drogué fait son travail de frère drogué, la petite sœur se prend la tête parce que tout le monde tente de la protéger contre son gré, on arrive à un scénario qui promet quelque chose d'intéressant. Sauf que la seconde partie vient absolument tout plomber. C'est compliqué d'en dire plus sans spoiler, mais elle n'a tellement rien à voir avec la première partie du roman que c'est à peine si on a l'impression de lire la même oeuvre, et je ne parle même pas du manque de cohérence.
La première partie est clairement l'intrigue la plus intéressante et la plus représentative du style de Grangé, et je l'ai lue avec les mêmes frissons d'impatience que ceux qui m'ont parcourue pendant
La ligne noire ou
la Forêt des Mânes. Dans pas mal de bouquins, je trouve que le tueur a souvent des raisons très bancales d'en arriver à des extrémités de fou furieux. Parce que non, avoir des parents violents n'est pas une raison suffisante pour faire d'un citoyen lambda un tueur énervé contre la société, on a besoin de plus. D'étoffer un peu, d'avoir aussi un minimum d'empathie pour lui, de comprendre les raisons de son geste. On est pas dans le révolutionnaire non plus, mais j'ai apprécié le travail sur le personnage du tueur. La relation entre Erwan et sa soeur Gaëlle contribue également pour beaucoup à l'intérêt parallèle de l'histoire. Erwan possède une vision idéalisée de l'ordre et de la justice, où tout est parfaitement en accord avec son sens de l'honneur, en cherchant à marcher sur les traces de son père tout en luttant pour s'en éloigner. Mais Gaëlle, elle, symbolise la jeunesse désabusée et le rejet le plus total des codes familiaux. Les traditions l'étouffent, elle fait partie de cette nouvelle génération qui se sent prise au piège entre la course aux technologies, l'envie stupide de se lancer dans la télé-réalité, le monde sexiste et la volonté d'être un déshonneur pour sa famille. Chacun des deux protagonistes représente une face de la même pièce, et on ne peut s'empêcher de regarder, fasciné, la lutte et l'infinie tendresse entre eux. Et au milieu de tout ça, pas de temps mort pour Lontano ! C'est la moindre des choses quand on a décidé de caler deux intrigues dans un seul roman, mais il faut avouer que de manière générale, les Grangé ne font pas partie des bouquins dont il faut avoir attaqué un quart avant que l'action ne démarre. En fait niveau action, Grangé c'est un peu le Michael Connelly du polar français, en beaucoup plus crade. Comme toujours, j'ai tout lu. Faut reconnaître ça à Grangé, il sait faire lire son livre en entier. Mais à côtés de ça, les points noirs sont tellement nombreux ici que je ne sais même pas par où commencer.
Jusqu'ici, chaque roman de Grangé était espacé de plusieurs années, ce qui n'est finalement pas très dérangeant. Attendre indéfiniment pour des histoires qui tiennent la route du début à la fin comme
Miserere, ça vaut le coup. Seulement, il a mis les bouchées doubles en écrivant quatre livres en quatre ans. Honnêtement, pour moi c'était déjà un mauvais signe. N'est pas Stephen King qui veut, et ici la qualité habituelle n'est clairement pas au rendez-vous. Ce qui explique sûrement les nombreux points culture mal amenés. Je suis la première à aimer apprendre des choses, alors pourquoi jeter ça dans la catégorie des points négatifs ? Parce que oui, Grangé a une bonne documentation sur le pays. Vous saurez tout sur le code d'honneur africain, sur la manière de saluer un chef d'Etat un peu dictateur sur les bords ou sur les plantes qu'on peut trouver dans la jungle, mais ce n'est pas la documentation, même fournie, qui fait tenir une intrigue. C'est clairement là que le roman pêche. J'ai eu souvent l'impression que l'auteur avait copié/collé une page Wikipédia pour augmenter son quotat. Autant se limiter à une intrigue simple mais efficace plutôt que de faire un croisement de registres qui rend le tout très indigeste. Sans oublier certains personnages caricaturaux au possible. Je veux dire, je sais parfaitement que la spécialité de Grangé, c'est le flic. D'ailleurs quand on en arrive aux adaptations, vous remarquerez que Jean Reno est souvent choisi pour le rôle phare, et ça n'a rien d'étonnant. Donc je m'attendais encore une fois à trouver un cliché de flic, un homme, un vrai, qui détruit des murs à mains nues le dimanche pour se détendre, qui hurle à genoux en plein milieu de la rue sans que personne n'appelle l'hôpital psychiatrique le plus proche, qui court plus vite que le métro, et qui n'en fait qu'à sa tête sans même se faire virer par ses supérieurs haussant les épaules parce que bon, c'est le meilleur de nos agents. Mais là, tout le monde est caricatural. Gaëlle est chiante comme pas possible à vouloir être protégée alors qu'elle passe le livre entier à gueuler sur frère parce qu'il la protège à longueur de temps. Et leur frère camé, on en parle ? Un mec défoncé 24h/24 qui n'arrive même pas à prendre en charge ses gamins ou à se rappeler la date du droit de visite, mais qui est une pointure dans le monde de la finance et adulé de tous. Et il s'emmerde même pas à cacher ses addictions, le gars, hein. Si j'avais su qu'on pouvait être millionnaire tout en se défonçant sur son lieu de travail et en venant au bureau fringué samedi sur dimanche ... Et voilà, là dessus, on en arrive donc à cette fin bâclée, qui va donner naissance à une suite en mai (que je ne suis pas sûre de lire, du coup). Quand je parle de fin bâclée, je n'exagère rien. L'impression que ça donne, c'est que sur les cinquante dernières pages, il ne savait pas comment terminer son intrigue bancale, alors il nous l'a résolue en dix lignes. Le gentil tue le méchant, le chien fonce le retrouver en courant au ralenti sur la plage, la femme regarde l'homme comme un sauveur, et ils restent là à admirer le coucher de soleil pendant que le générique défile. Fin. Rassurez-vous, ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais niveau cliché et facilité, on est en plein dedans.
En guise de conclusion, je ne dirai pas que ce livre est mauvais. Il est juste décevant. Si je l'avais lu sans que ce soit un Grangé, ça serait peut-être passé. Je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression constante de lire un scénario de mauvais épisode de
Cordier Juge & Flic. Je ne comprends pas pourquoi nous proposer une première intrigue assez sympa et venir tout défoncer ensuite sous prétexte que le roman porte sur l'Afrique et les relations familiales. Bref, si vous ne connaissez pas Grangé, vous adhérerez au livre et lui pardonnerez ses défauts, et ne pourrez qu'en apprécier davantage ses autres bouquins. Si au contraire, vous êtes un habitué, laissez tomber.
Clairement une des œuvres les moins glorieuses de l'écrivain, qui s'est un peu perdu en chemin.